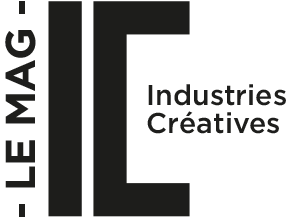Et la lumière fut : le coup de maître du Musée Soulages de Rodez
L’esprit de Pierre Soulages, maître de l’abstraction disparu en 2022, vit encore à Rodez, dans l’Aveyron. Un musée dédié, inauguré il y a une dizaine d’années en présence du peintre, accueille pas moins de 130 000 visiteurs par an, venus du monde entier. Dans l’entretien qui suit, son directeur, Benoît Decron, analyse les partis-pris muséographiques visant à mettre en valeur l’œuvre singulière de Soulages. Ou comment la décoration du musée n’est jamais décorative au sens classique, mais agit plutôt comme une extension du langage de Soulages.
A l’occasion d’un reportage de TV5 Monde en 2014, Pierre Soulages déclarait que les gens doivent regarder ses toiles « avec les yeux et non avec ce qu’ils ont dans la tête ». Qu’est-ce que ça vous inspire ?
Il a aussi dit : « La peinture, ça ne se regarde pas, ça se fréquente. » Il n’était pas dogmatique et ne voulait pas que tout soit intellectualisé. Il est certain que si on ne sait pas regarder une œuvre, poser ses yeux et se détacher des cartels, on perd beaucoup. A ce sujet, il n’y a rien de tel que de visiter un musée quand on n’a pas mangé. Parce qu’on a faim, dans toutes les sens du terme. On a le regard beaucoup plus aiguisé et l’expérience s’en trouve bien plus agréable. Jeune conservateur, je pensais qu’on pouvait vivre dans les musées et y passer huit heures d’affilée. Mais c’est idiot, parce qu’en réalité, notre attention baisse au fil du temps. Même au Louvre, in fine, on voit les choses parce qu’on doit les voir, mais est-ce qu’on les voit bien ? Il ne faut pas être trop gourmand, mais ça demande un peu d’entraînement. Visiter un musée, ce n’est pas naturel.
Au-delà des tableaux, les visiteurs viennent-ils aussi à Rodez pour vivre une expérience d’immersion totale au sein de votre musée ?
Oui, car nous avons toujours appréhendé le musée de cette façon, avec une descente au sous-sol pour découvrir la collection. Une fois en bas, deux plateaux sont offerts aux visiteurs : une exposition permanente et une exposition temporaire, 1400 m² d’un côté et 500 m² de l’autre. Les murs et les sols sont en métal gris, on baigne dans l’acier compressé, avec une lumière très particulière, mais on bénéficie bien entendu de l’éclairage des œuvres de Pierre Soulages. Au global, le musée ressemble, si j’ose dire, à un espace placentaire.
Comment pense-t-on la scénographie d’un musée avec une œuvre aussi forte et singulière que celle de Soulages ?
Je n’appelle pas ça de la scénographie… En convoquant ce mot, je pense à des musées d’histoire ou thématiques dans lesquels il y a beaucoup de mobilier, une mise en scène très travaillée, etc. Au sein de notre musée, il n’y a aucune mise en scène ou presque. Nous avons créé un espace pour les tableaux et chaque salle agit comme un cadre. Le mobilier scénographique est réduit à sa plus simple expression. On retrouve quelques vitrines, très qualitatives certes, mais c’est à peu près tout. Il s’agissait d’un souhait de Soulages, mais aussi des architectes de RCR, qui, rappelons-le, ont reçu le Prix Pritzker en 2017.
Et pour ma part, j’aime les accrochages au sein d’espaces très épurés et flexibles. D’ailleurs, plutôt que de parler de scénographie, je parlerais d’accrochage. A ce sujet, il faut savoir que Soulages a toujours vu l’accrochage de son musée comme une exposition temporaire, qui serait sans fin. Il pensait qu’un musée qui ne bouge pas, c’est comme un magasin où on ne change pas les vitrines. Nous renouvelons donc l’accrochage tous les ans, en faisant preuve d’une grande souplesse. J’aime ce processus, car un accrochage représente une manière de recréer une œuvre d’art, ou, en tout cas, une occasion de lui offrir une nouvelle vie.
Vous avez fait le choix de murs sombres…
Nous avons travaillé main dans la main avec Philippe Maffre pour l’aménagement intérieur du musée. Ce qu’on voulait, c’est mettre en valeur l’œuvre pour l’œuvre. Après se posait la question, dans un objectif d’immersion, d’installer des œuvres noires sur un fond gris noir. Mais l’œuvre est tellement puissante qu’avec un bon éclairage, et l’éclairage est très important pour Pierre Soulages, on fait véritablement la distinction entre la peinture et le mur lui-même.C’est la magie des œuvres de Soulages : elles sont tellement puissantes et expressives que ça suffit. J’ai tendance à penser qu’une belle peinture triomphe toujours, quelle que soit la couleur du mur, à part des choses vraiment scandaleuses.
Aviez-vous peur de dérouter certains visiteurs avec cette inversion des rapports de couleurs ?
Je pense que ça peut être déroutant pour certains visiteurs. Mais il faut bien saisir les subtilités de la conception. Au niveau des matériaux utilisés au sein du musée, il existe des variations importantes. A l’extérieur, le bâtiment est en acier Corten, et à l’intérieur, c’est de l’acier calaminé. Il faut aussi comprendre qu’avec les œuvres de Soulages, on ne peut pas mettre un mur blanc pur. Donc nous avons injecté 13 à 14% de noir dans du blanc, avec une petite pointe d’orange ou de rouge. De nombreux tests ont été menés.
Nous avons eu beaucoup de chance d’avoir Soulages à nos côtés dans ce processus. La dernière année avant l’ouverture, il était présent tous les mois, collaborant avec notre équipe et les architectes. Contrairement à Picasso, Chagall, ou Fernand Léger, il a suivi de près la construction de son musée, son aménagementet l’accrochage. Il ne pilotait pas les choses, mais il était très vigilant et directif, sans toutefois exclure la discussion.
L’imprimé occupe une place subtile mais essentielle dans le Musée Soulages, à la fois comme œuvre et comme vecteur de transmission…
Il y a un peu de signalétique au sein du musée. Un panneau explicatif en français, anglais et espagnol est installé dans chacune des huit salles. Nous avons fait le choix de les sérigraphier directement sur les murs, pour une meilleure intégration. Et au niveau des cartels, on a fait au plus simple, en noir et blanc, dans un esprit de discrétion, sans surcharge informative.
Quant à l’œuvre imprimée de Soulages, elle est moins connue du grand public que ses tableaux grands formats, mais elle a toute sa place à Rodez. Il a beaucoup exploré les techniques d’impression et la salle dédiée à l’œuvre imprimée de Soulages est importante, comprenant des lithographies, des eaux-fortes et des sérigraphies, présentées sans Marie-Louise, sur des cimaises transparentes. Soulages considérait son œuvre imprimée, ses « multiples » comme il les appelait, à valeur égale de ses œuvres sur toile. Il ne faisait pas de hiérarchie entre les deux.