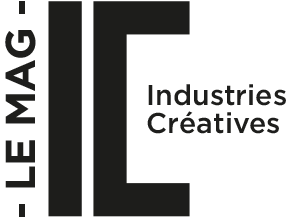Communication visuelle, industries graphiques : la France n’a pas dit son dernier mot
Il faut reconnaître que les obstacles au made in France ne manquent pas et l’industrie nationale a aujourd’hui besoin d’un sérieux coup de pouce pour continuer sa marche en avant, de la part des donneurs d’ordre comme des pouvoirs publics. Mais il reste des raisons d’espérer. La France a trop d’atouts en mains pour lâcher son industrie, là, comme ça, maintenant. Le pays regorge de talents, de dirigeants ambitieux et résilients. De la création à la production, la French touch au sein des industries graphiques n’a pas fini de nous épater.
Les esprits chagrins vous diront qu’il est déjà mort, avant même d’avoir prospéré. Que le Covid l’a fait renaître et que la montée de l’inflation l’a enterré. La situation est bien plus nuancée que cela. Le made in France n’est pas mort. Il n’est même pas moribond. Pour preuve, la dernière édition du salon du Made in France, la 12e du nom, organisée sur quatre jours à Paris au mois de novembre dernier, a rassemblé un nombre record de 1 000 exposants et il a attiré 110 000 visiteurs. Le succès de cet évènement grand public prouve d’une part que de plus en plus de consommateurs voient le made in France comme un gage de traçabilité, de respect des normes sociales et environnementales, et de soutien à l’économie locale, et d’autre part que le made in France, ce n’est pas seulement le luxe et la gastronomie. C’est aussi l’industrie. Des exposants comme Bic, Atol, Exacompta, ou Duralex étaient présents sur le salon. Des grands noms qui tentent, chacun à leur manière, de conquérir les consommateurs français. Ou plutôt reconquérir ? Car, selon une étude de l’INSEE parue en 2023, la part du made in France dans la demande intérieure pour les produits manufacturés est passée de 82 à 38 % entre 1965 et 2019. Et, dans le même temps, le pays s’est largement désindustrialisé.
Dans ce contexte mi-figue mi-raisin, les défis à relever pour le made in France sont multiples. On peut citer en premier lieu des frais de production élevés : le coût du travail en France est bien plus important qu’en Asie ou en Europe de l’Est, ce qui rend certains produits ou services plus coûteux. L’industrie française doit donc trouver des moyens de rationaliser ses coûts, sans sacrifier la qualité. Dans le même ordre d’idée, la compétition internationale fait rage. Le made in France doit faire face à une concurrence accrue, notamment en matière de technologie et de production à grande échelle. La pénurie de main-d’œuvre qualifiée représente aussi une problématique majeure. Certains secteurs industriels en France, pour ne pas dire tous, rencontrent des difficultés à recruter du personnel, ce qui freine la production et l’innovation.
Toutes ces problématiques, les professionnels français des industries graphiques et de la communication visuelle les connaissent bien. Alors ils proposent des solutions concrètes. On fait le point, dans le cadre d’une sélection forcément parcellaire, avec une interview de Christophe Divi, membre des Forces Françaises de l’Industrie, un reportage chez Maison Seiller, spécialiste de la PLV, et un portrait de Coqli, jeune pousse du web-to-pack.
Christophe Divi (Forces Françaises de l’Industrie) : « Les JO de Paris 2024 resteront un mètre-étalon pour le made in France »

Actif sur tous les fronts, Christophe Divi est membre des Forces Françaises de l’Industrie et fondateur de Transitions_2050, un cabinet de conseil accompagnant les organisations dans leurs politiques de transition écologique, d’industrialisation, de développement économique local et d’inclusion. Il était aussi directeur de la Plateforme ESS 2024, qui visait à connecter les entreprises solidaires et circulaires aux opportunités économiques générées par l’organisation des Jeux de Paris 2024. Volontiers optimiste, le made in France a encore beaucoup à offrir selon lui.
A l’heure où les Français semblent plus préoccupés par leur porte-monnaie que par l’origine des produits qu’ils achètent, et où l’un des fleurons du made in France comme le Slip français est engagé dans une course contre la montre pour sa survie, peut-on dire que le made in France est moribond ?
Je ne suis pas complètement d’accord sur la conclusion. Je pense, qu’en effet, un certain nombre de grandes entreprises du made in France, soit parce qu’elles enregistrent des volumes de production importants, soit car elles sont des acteurs historiques comme Duralex, voient leur modèle industriel mis en difficulté. Dans ce contexte, elles ont besoin d’un appui, des consommateurs comme des pouvoirs publics.
Il faut se féliciter du fait que le salon du made in France qui s’est tenu la semaine dernière (NDLR : cet entretien a été réalisé le 19 novembre) n’a jamais enregistré autant de visiteurs. Dans la foulée, des alternatives au « Black Friday » se sont organisées, en promouvant un certain nombre de produits et de services fabriqués en France et qui rencontrent leur marché en termes de demande de consommation. Donc je pense qu’il existe aujourd’hui une attente très claire sur le sujet, même si on constate une petite contradiction entre l’attentedes consommateurs et la situation économique de ces grandes PME ou ETI du made in France.
Il y a quelque chose d’important qui se joue dans les prochains mois pour les filières du made in France, pour la survie même de l’industrie. Et pour être honnête, je pense qu’on en demande un peu trop aux consommateurs français, qui répondent présents autant qu’ils peuvent. Le surcoût des produits fabriqués dans notre pays est bien réel, et on peut le justifier en rentrant dansle détail des chaînes de production, en parlant d’ancrage local ou des créations d’emplois, parfois issues du secteur de l’inclusion. Mais j’attends plus de soutien des pouvoirs publics et des entreprises privées, des investisseurs et des banquiers. Nous vivons un moment décisif et ils doivent tous se mobiliser.
Selon vous, la question du redéveloppement territorial est essentielle, et ce, à l’échelle de la France entière.
Oui, car il existe de nombreux territoires en revitalisation, des territoires ayant connu une désindustrialisation ces dernières années et qui ont besoin de réimplanter des activités de production industrielle ou de sous-traitance industrielle. Certains bassins d’emploi ont enregistré des départs d’entreprises, comme à Béthune avec Bridgestone, mais aussi dans l’Est de la France, ou à Pau, Chalon et Orléans. Et on sait maintenant, à la faveur de plusieurs études, que la création d’un emploi industriel peut générer, en effets indirects, jusqu’à 30 emplois sur un territoire. Parce que cela crée des activités secondaires liées aux activités industrielles.
Cette dimension territoriale est donc nécessaire, mais beaucoup de conditions doivent être levées pour que ce soit possible. Il y a la question du foncier disponible, en premier lieu, pour s’installer sur des sites de production industrielle, avec des usines qui soient suffisamment capacitaires. Et puis il y a la desserte. Ces éléments s’avèrent très liés aux politiques d’aménagement, de transport et de résidentiel sur ces territoires. Donc quand on parle de structuration de filières industrielles, la logique se base sur l’ensemble des politiques publiques devant être mobilisées pour pouvoir permettre l’implantation d’entreprises industrielles sur ces territoires.
L’une des solutions, aussi, pour cimenter cet ancrage local, c’est la mutualisation et le partage des forces de production ?
Sur le sujet du recrutement et de l’économie circulaire, on voit beaucoup de démarches de coopération qui se mettent en place à l’échelle du territoire. Sur les questions de recrutement, déjà, parce que ce sont des métiers en pénurie. Les entreprises ont du mal à trouver la main d’œuvre correspondante, et pas nécessairement sur un niveau de qualification supérieur d’ailleurs, y compris sur des métiers BAC ou infra-BAC. Des actions de temps partagé, dans les fonctions de production ou de support, et des groupements d’employeurs se mettent en place dans le secteur industriel. C’est quelque chose qui fonctionne bien et qui mérite d’être démultiplié.
Sur le plan de l’économie circulaire, nous observons des démarches s’inscrivant dans une écologie industrielle territoriale. A l’échelle d’un territoire, on regarde les 20 ou 30 PME industrielles qui sont les plus génératrices de déchets et on arrive à mettre en place des dispositifs de tri et de collecte mutualisés entre ces PME, ce qui permet ensuite de voir émerger des entreprises de traitement des déchets. De cette façon, on structure la filière, entre ceux qui génèrent des déchets et ceux qui les traitent en seconde vie. Dans le champ de l’économie circulaire, et donc de la transition écologique au sens large, on parle beaucoup de décarbonation, parce que les sites industriels sont très générateurs de carbone. Mais l’économie circulaire, et notamment la partie en aval, comme le traitement des déchets, représente un levier de coopération efficace entre différentes entreprises. Le territoire français le plus exemplaire sur ce sujet est probablement le Pays basque.
Le dernier levier que j’identifie, c’est la question des achats. Parce que, au même titre que les consommateurs, les entreprises achètent. Elles ont besoin d’outils, d’équipements, de matériel, d’infrastructures, mais aussi de services, comme du graphisme par exemple. Des enjeux de mutualisation sont clairs sur le sujet, afin de réduire les coûts grâce à des volumes de commandes plus importants. Cela permet de travailler davantage avec des entreprises, si ce n’est de son territoire, en tout cas françaises, plutôt que d’acheter des consommables ou des outils qui viennent du fond de l’Europe ou d’Asie.
Les imprimeurs français se sont étonnés de leur faible implication dans les JO de Paris 2024, au profit de productions polonaises. Comment expliquer ce delta entre la déclaration d’intention du comité d’organisation des Jeux Olympiques (COJO), autour du local et du responsable, et la réalité des productions ?
On ne peut pas nier les engagements et l’ambition très forte du COJO sur le recours à des entreprises locales. Mais le COJO était soumis à la commande publique et, contrairement au droit européen, il n’est pas possible, dans notre pays, d’inscrire un critère de préférence locale dans les grands marchés publics. Malgré tout, nous avons tenté de pousser un certain nombre de critères liés à l’empreinte carbone, au lieu d’approvisionnement et à la seconde vie. Si je prends la filière de la communication visuelle au sens large, celle de l’impression, de la signalétique ou de l’habillage, nous avons, je crois, réussi à travailler majoritairement avec des PME françaises.
Je reconnais que certains arbitrages ont été perdus. Nous n’avons pas atteint un total de 100 % d’entreprises nationales, parce que le marché était trop gros et que les calendriers étaient très serrés. Et il faut garder en tête que la commande publique reste une compétition, pendant laquelle on compte bien plus de perdants que de lauréats. L’entreprise Doublet, dans le Nord, a raflé une grosse partie du marché et ils ont, globalement, travaillé en interne.
Au final, la stratégie responsable des achats des JO de Paris 2024 va laisser une empreinte et un héritage. Encore une fois, il y a des sujets sur lesquels on aurait aimé aller plus loin, notamment sur le textile ou les produits dérivés, mais nous possédons désormais un cadre, de bons résultats et des retours d’expérience, aussi sur ce qui n’a pas marché, pour pouvoir travailler sur de futurs événements, grands ou petits. Les JO de Paris 2024 resteront un mètre-étalon pour le made in France.